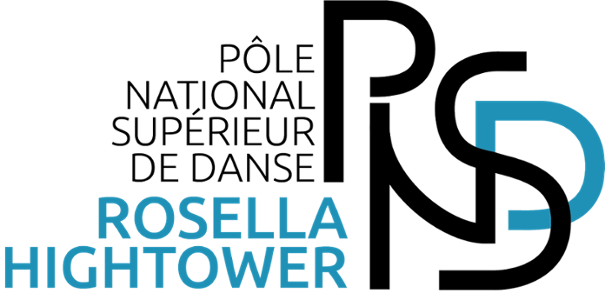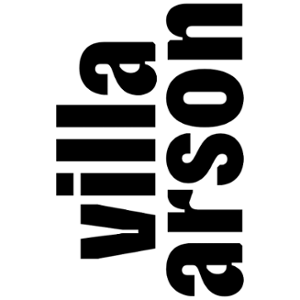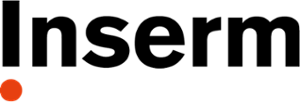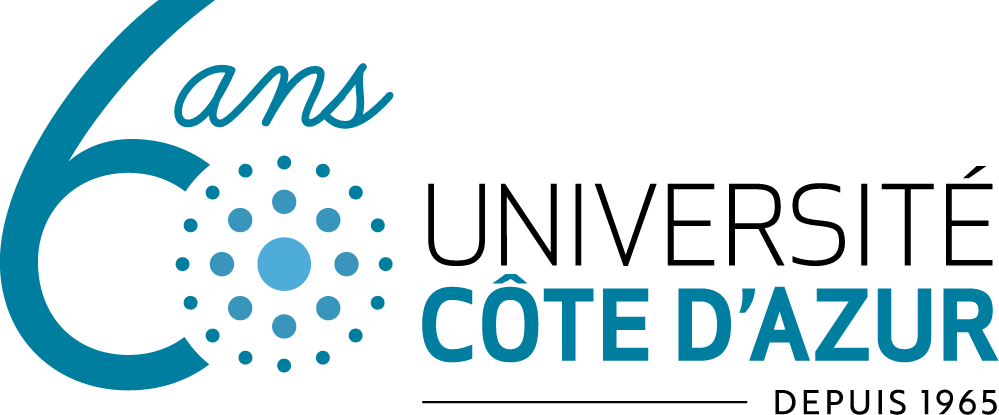Une doctorante d’Université Côte d’Azur (GREDEG) à Bonn pour les 62ᵉ Sessions des Organes Subsidiaires de l’UNFCCC (SB62)
- IDEX
- International
Publié le 7 juillet 2025
–
Mis à jour le 7 juillet 2025
Date(s)
le 7 juillet 2025

Dans le cadre de sa stratégie de diplomatie scientifique, Université Côte d’Azur s’engage activement dans les arènes de négociations environnementales multilatérales, une des actions prioritaires de l'Initiative d’Excellence.
Convaincue que les connaissances scientifiques produites dans les universités doivent être prises en compte par les décideurs politiques, notre établissement leur apporte un éclairage scientifique tout au long de l’année au niveau local, national, et international. Depuis quelques années, ce travail se fait aussi directement avec les Nations Unies à la COP, aux réunions annuelles de Bonn, et récemment pendant l’UNOC3 à Nice.
Les SB62, ou 62ᵉ sessions des organes subsidiaires de l’UNFCCC, se sont tenues du 16 au 26 juin 2025. Ces réunions techniques font la transition entre les COP et préparent par d’intenses négociations entre les 198 parties représentées les accords clés qui seront adoptés à la COP.
Après avoir envoyé une forte délégation à la COP29 à Bakou et en préparation de la COP30 à Belém, au Brésil, Université Côte d’Azur était représentée à Bonn par une doctorante du GREDEG, Abir Khribich. Très impliquée dans les actions de l’Université, notamment dans l’exercice des plaidoyers académiques et lors de la table-ronde « Enjeux climatiques & diplomatie scientifique » qui clôturait la COP Miroir 2024, Abir Khribich prépare une thèse sur les leviers de la consommation des énergies renouvelables à l’échelle micro et macroéconomique.
Récompensée pour ses plaidoyers et son engagement et compte tenu de l’adéquation avec ses projets de recherche, elle a obtenu avec le soutien de l’IdEx une accréditation pour assister pendant 3 jours aux négociations. Elle nous livre son analyse et son regard sur ces quelques jours à Bonn.
Les sessions 2025 de Bonn se sont logiquement inscrites dans la continuité des avancées annoncées à la COP29 à Bakou. Les négociations pendant ces deux semaines de juin se sont donc concentrées sur l’adoption et la mise en œuvre de divers mécanismes de financement. Elles ont permis de préparer techniquement les prochaines étapes de mise en œuvre, plus précisément autour du Nouvel Objectif Chiffré Collectif (NCQG), des questions d’adaptation, des mécanismes de coopération internationale (article 6 des Accords de Paris), et du suivi du Bilan mondial (Global Stocktake).
Ces sessions intermédiaires – moins médiatiques que la COP car concentrées sur les aspects techniques - sont essentielles pour structurer les négociations politiques en vue de la COP30, prévue à Belém au Brésil en novembre 2025.
Avec 198 parties représentées (197 pays et l’UE) et une logique de consensus, il y a toujours beaucoup de lourdeur qui freine l’avancée des négociations. Celles-ci peuvent rester en suspens des journées entières à cause d’un désaccord pour une phrase ou même un mot. Le début des négociations a par exemple été très lent, les délégués ayant mis près de deux jours à adopter l’ordre du jour. Ce retard s’explique principalement par les désaccords sur l’inclusion d’un point spécifique concernant les obligations financières des pays développés, un point bloquant récurent qui avait déjà créé des tensions au dernier jour de la COP29.
Faute de consensus, les questions non résolues sont souvent reportées aux sessions suivantes. Par exemple, les discussions autour du Programme de mise en œuvre des Technologies (TIP) se sont conclues sans unanimité et reprendront ultérieurement. Un autre point de négociations important portait sur l’adaptation au changement climatique, en particulier à travers les travaux sur la définition d’une liste d’indicateurs mondiaux pour suivre les progrès de l’objectif mondial d’adaptation (GGA). Les parties ont cherché sans succès à aboutir à une sélection limitée d’indicateurs (moins de 100).
Malgré ces difficultés inévitables, quelques avancées notables ont été enregistrées. Les discussions sur le Fonds pour l’adaptation (Adaptation Fund) ont progressé, avec un consensus pour organiser sa transition vers un mécanisme pleinement aligné sur l’Accord de Paris. Un compromis a également été trouvé sur une liste d’indicateurs pour évaluer les progrès vers l’objectif mondial d’adaptation, incluant l’accès, la qualité et les montants de financements pour l’adaptation – une demande clé des pays du Sud. Enfin, un accord minimal a permis de « prendre note » des derniers rapports de l’Organisation Météorologique Mondiale, qui estiment le réchauffement actuel entre 1,34°C et 1,41°C, mais certains pays ont exprimé leur frustration face à la difficulté d’inclure explicitement l’objectif de 1,5°C.
La plupart des dossiers traités cette année à Bonn n’ont pas abouti à des décisions formelles, mais comme souvent, les progrès réalisés serviront de base pour la COP30 à Belém. Les négociations continueront d’ici là entre les parties sur les points bloquants afin que des progrès aussi ambitieux que possible puissent être obtenus au Brésil. Des avancées importantes seront attendues sur les mécanismes de financement déjà cités ainsi que sur le Fonds sur les Pertes et Préjudices (Loss and Damage Fund) et les contributions déterminées au niveau national (NDCs). Les pays les plus impactés espèrent notamment des promesses de financement (et de dons) bien plus importantes de la part des pays développés.
En parallèle de ces séances de négociation (qui ne sont pas toutes ouvertes aux observateurs), de nombreuses conférences et tables-rondes ont lieu avec des membres de la société civile, des peuples dits « indigènes », des scientifiques, des responsables politiques, etc. Une grande diversité de peuples et minorités y sont représentés, et un grand nombre de sujets abordés.
Cela donne l’impression que l’ensemble de la planète se donne rendez-vous pour discuter de son avenir et pour trouver ensemble des solutions à la montée des eaux, à la surpêche, à la transition énergétique juste, à la protection des savoirs ancestraux, ou encore à la désertification. Le tout en se donnant comme objectif de respecter les droits des peuples, des femmes, l’environnement local, et en prenant en compte les spécificités de chacun, les savoirs autochtones, etc.
Participer aux SB62 était une belle opportunité d’approfondir la compréhension des mécanismes des négociations climatiques et leur extrême complexité. Abir va pouvoir s’inspirer de cette expérience pour continuer sa thèse et continuer son investissement avec l’université sur les enjeux climatiques et environnementaux, par exemple en préparant de nouveaux plaidoyers académiques.
En savoir plus sur la stratégie de diplomatie scientifique d'Université Côte d'Azur
Les SB62, ou 62ᵉ sessions des organes subsidiaires de l’UNFCCC, se sont tenues du 16 au 26 juin 2025. Ces réunions techniques font la transition entre les COP et préparent par d’intenses négociations entre les 198 parties représentées les accords clés qui seront adoptés à la COP.
Après avoir envoyé une forte délégation à la COP29 à Bakou et en préparation de la COP30 à Belém, au Brésil, Université Côte d’Azur était représentée à Bonn par une doctorante du GREDEG, Abir Khribich. Très impliquée dans les actions de l’Université, notamment dans l’exercice des plaidoyers académiques et lors de la table-ronde « Enjeux climatiques & diplomatie scientifique » qui clôturait la COP Miroir 2024, Abir Khribich prépare une thèse sur les leviers de la consommation des énergies renouvelables à l’échelle micro et macroéconomique.
Récompensée pour ses plaidoyers et son engagement et compte tenu de l’adéquation avec ses projets de recherche, elle a obtenu avec le soutien de l’IdEx une accréditation pour assister pendant 3 jours aux négociations. Elle nous livre son analyse et son regard sur ces quelques jours à Bonn.
Les sessions 2025 de Bonn se sont logiquement inscrites dans la continuité des avancées annoncées à la COP29 à Bakou. Les négociations pendant ces deux semaines de juin se sont donc concentrées sur l’adoption et la mise en œuvre de divers mécanismes de financement. Elles ont permis de préparer techniquement les prochaines étapes de mise en œuvre, plus précisément autour du Nouvel Objectif Chiffré Collectif (NCQG), des questions d’adaptation, des mécanismes de coopération internationale (article 6 des Accords de Paris), et du suivi du Bilan mondial (Global Stocktake).
Ces sessions intermédiaires – moins médiatiques que la COP car concentrées sur les aspects techniques - sont essentielles pour structurer les négociations politiques en vue de la COP30, prévue à Belém au Brésil en novembre 2025.
Avec 198 parties représentées (197 pays et l’UE) et une logique de consensus, il y a toujours beaucoup de lourdeur qui freine l’avancée des négociations. Celles-ci peuvent rester en suspens des journées entières à cause d’un désaccord pour une phrase ou même un mot. Le début des négociations a par exemple été très lent, les délégués ayant mis près de deux jours à adopter l’ordre du jour. Ce retard s’explique principalement par les désaccords sur l’inclusion d’un point spécifique concernant les obligations financières des pays développés, un point bloquant récurent qui avait déjà créé des tensions au dernier jour de la COP29.
Faute de consensus, les questions non résolues sont souvent reportées aux sessions suivantes. Par exemple, les discussions autour du Programme de mise en œuvre des Technologies (TIP) se sont conclues sans unanimité et reprendront ultérieurement. Un autre point de négociations important portait sur l’adaptation au changement climatique, en particulier à travers les travaux sur la définition d’une liste d’indicateurs mondiaux pour suivre les progrès de l’objectif mondial d’adaptation (GGA). Les parties ont cherché sans succès à aboutir à une sélection limitée d’indicateurs (moins de 100).
Malgré ces difficultés inévitables, quelques avancées notables ont été enregistrées. Les discussions sur le Fonds pour l’adaptation (Adaptation Fund) ont progressé, avec un consensus pour organiser sa transition vers un mécanisme pleinement aligné sur l’Accord de Paris. Un compromis a également été trouvé sur une liste d’indicateurs pour évaluer les progrès vers l’objectif mondial d’adaptation, incluant l’accès, la qualité et les montants de financements pour l’adaptation – une demande clé des pays du Sud. Enfin, un accord minimal a permis de « prendre note » des derniers rapports de l’Organisation Météorologique Mondiale, qui estiment le réchauffement actuel entre 1,34°C et 1,41°C, mais certains pays ont exprimé leur frustration face à la difficulté d’inclure explicitement l’objectif de 1,5°C.
La plupart des dossiers traités cette année à Bonn n’ont pas abouti à des décisions formelles, mais comme souvent, les progrès réalisés serviront de base pour la COP30 à Belém. Les négociations continueront d’ici là entre les parties sur les points bloquants afin que des progrès aussi ambitieux que possible puissent être obtenus au Brésil. Des avancées importantes seront attendues sur les mécanismes de financement déjà cités ainsi que sur le Fonds sur les Pertes et Préjudices (Loss and Damage Fund) et les contributions déterminées au niveau national (NDCs). Les pays les plus impactés espèrent notamment des promesses de financement (et de dons) bien plus importantes de la part des pays développés.
En parallèle de ces séances de négociation (qui ne sont pas toutes ouvertes aux observateurs), de nombreuses conférences et tables-rondes ont lieu avec des membres de la société civile, des peuples dits « indigènes », des scientifiques, des responsables politiques, etc. Une grande diversité de peuples et minorités y sont représentés, et un grand nombre de sujets abordés.
Cela donne l’impression que l’ensemble de la planète se donne rendez-vous pour discuter de son avenir et pour trouver ensemble des solutions à la montée des eaux, à la surpêche, à la transition énergétique juste, à la protection des savoirs ancestraux, ou encore à la désertification. Le tout en se donnant comme objectif de respecter les droits des peuples, des femmes, l’environnement local, et en prenant en compte les spécificités de chacun, les savoirs autochtones, etc.
Participer aux SB62 était une belle opportunité d’approfondir la compréhension des mécanismes des négociations climatiques et leur extrême complexité. Abir va pouvoir s’inspirer de cette expérience pour continuer sa thèse et continuer son investissement avec l’université sur les enjeux climatiques et environnementaux, par exemple en préparant de nouveaux plaidoyers académiques.
En savoir plus sur la stratégie de diplomatie scientifique d'Université Côte d'Azur