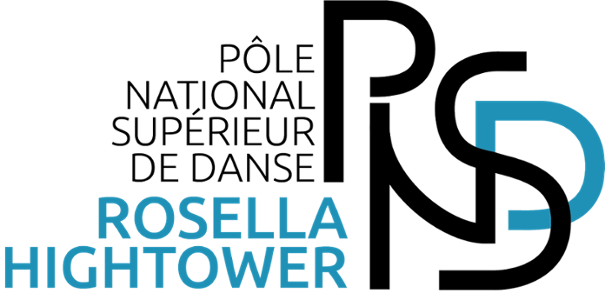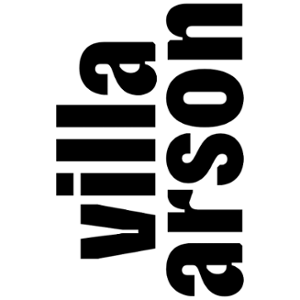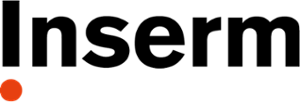InterMMed : Interactions et Multiplicité des trajectoires historiques entre Paléolithique et Mésolithique au nord et au sud de la Méditerranée
En quelques mots
Le projet de recherche engage une démarche techno-économique interdisciplinaire pour comprendre le raisons de l'apparente stabilité des modes de vie dans l’espace méditerranéen de la fin du Paléolithique, une période de variations rapides et contrastées du climat qui entrainent des reconfigurations radicales des environnements..
PROJET DE RECHERCHE DE L'AXE 2
DATE : 2025
RESPONSABLE : Antonin Tomasso, CEPAM
DISCIPLINES : Archéologie, Pétrographie sédimentaire
MOTS-CLÉS : Préhistoire ; Méditerranée ; Changement climatique ; Réseaux ; Cultures
Description du projet
CONTEXTE
La fin du Paléolithique en Europe, entre le dernier maximum glaciaire (ca. -20 000 ans BP) et le début de l’interglaciaire tempéré actuel (ca. -10 000 ans BP) recouvre une période de variations rapides et contrastées du climat qui entrainent, dans l’espace méditerranéen, des reconfigurations radicales des environnements (montée du niveau marin ; retrait des glaciers d’altitude ; progression du couvert forestier ; remplacement des faunes et flores glaciaires par les espèces méditerranéennes). Parallèlement, dès -14 000 ans cal. BP, au Proche-Orient, les prémices de la néolithisation initient une transformation radicale des sociétés qui va progressivement s’étendre à l’ensemble du bassin méditerranéen selon des modalité et des temporalités très différentes d’une rive à l’autre.
Les recherches menées sur la fin de la Préhistoire dans le Bassin méditerranéen restent fortement cloisonnées chronologiquement et géographiquement. Par ailleurs, l’étude des sociétés préhistoriques et de leurs organisations sociales, économiques et territoriales, repose sur un ensemble limité d’indices matériels. Or, si les industries en pierre taillée ont été largement investies pour identifier des cultures et élaborer des sériations chronologiques, leur dimension économique et sociale a été peu explorée, notamment pour le Paléolithique où l’absence de spécialisation artisanale ne semble offrir que peu de prise à l’analyse économique. Initiée dès les années 1980 (Perlès, 1980), la techno-économie offre de puissants outils pour aborder de telles problématiques (Tomasso et Rots, 2021), mais son déploiement a été limité par des verrous analytiques récemment débloqués par les développements en pétroarchéologie (Caux, 2015) et en tracéologie (Rots, 2010).
OBJECTIFS
Dans l’ouest du Bassin méditerranéen, les modes de vies fondés sur une économie de chasse et de collecte perdurent jusqu’à la colonisation de certains territoires par des populations néolithisées. Deux hypothèses pourraient rendre compte de cette stabilité régionale des modes de vie paléolithiques : soit elle n’est qu’apparente et des dynamiques de transformation sont à l’oeuvre ; soit les formes sociales héritées de la période glaciaire sont capables d’une remarquable résilience.
Le projet InterMMed engage une démarche techno-économique interdisciplinaire pour éprouver ces deux hypothèses. Il s’appuie sur des collaborations pluridisciplinaires entre Préhistoire et Sciences de la Terre, indispensables à l’étude des approvisionnements en matières premières et sur l’élaboration de nouvelles collaborations internationales. Il participe d’une démarche de structuration disciplinaire de la techno-économie.
MÉTHODE
Le projet InterMMed est organisé autour de deux ateliers régionaux et thématiques.
- Atelier 1 : Stabilité des sociétés Paléolithiques au Sud de l’Europe, le syndrome Épigravettien. L’atonie des assemblages lithiques du sud de l’Europe à la fin du Paléolithique se traduit par une difficulté persistante à cerner des ensembles chronoculturels. Sur plus de 10 000 ans, l’Épigravettien s’étend du Rhône au Caucase et les premières industries du Mésolithique ne semblent pas introduire de rupture. Cet atelier a pour objectif d’évaluer la réalité de cette stabilité en analysant et en comparant les systèmes de production à différents moments de cette longue période sous un angle économique.
- Atelier 2 : entre Paléolithique et Mésolithique au nord de l’Afrique. La séquence culturelle en Afrique du nord (Ibéromaurusien puis Capsien) présente des similarités avec la succession du Paléolithique supérieur et du Mésolithique en Europe. Cette similarité pourrait trahir l’expression de processus analogues ou résulter d’une diffusion depuis l’Afrique d’innovations culturelles (Perrin, 2020). Cet atelier documentera des systèmes de production d’Afrique du Nord pour nourrir une approche comparative.
Interdisciplinarité et partenariats
RESPONSABLE DU PROJET
Antonin Tomasso, préhistorien, Chargé de recherche au CNRS au laboratoire Cultures – Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), Université Côte d'Azur
Christophe Matonti, Maître de conférences et géologie, GéoAzur, Université Côte d'Azur

CHERCHEURS ET LABORATOIRES PARTENAIRES
- Observatoire de la Côte d'Azur Université Côte d'Azur UMR 7329 CNRS - UR 082IRD
- LAMPEA UMR 7269 AMU CNRS
- University of Sousse / ISTLS Department of History, Faculty of arts and humanities
Résultats et valorisation
- Publications
-
À venir
- Conférences
- Diffusion de la recherche
- ANR et autres financements